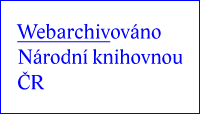Qu’est-ce que’un livre ? Réponse à une question de Kant
Roger Chartier
Qu’est-ce qu’un livre ? La question n’est pas neuve. Kant la formule explicitement en 1798 dans les Principes métaphysiques de la Doctrine du droit[1]. La première raison en est sa participation au débat ouvert en Allemagne depuis 1773 sur la propriété littéraire et les contrefaçons de livres. Cette discussion, qui implique philosophes, poètes et éditeurs, tient aux traits spécifiques de l’activité d’édition dans l’Empire germanique. La fragmentation politique de l’Empire impose, en effet, de fortes limites aux privilèges de librairie dont la légalité ne vaut que pour un territoire particulier – et souvent restreint. Par conséquent, la reproduction des œuvres hors de la souveraineté qui a accordé le privilège est massive et, si elle est tenue comme juridiquement légitime par les libraires éditeurs situés dans d’autres états, elle est considérée comme intellectuellement illégitime par les auteurs et leurs premiers éditeurs qui se considèrent comme injustement spoliés de leur droit. Pour Kant, comme pour Klopstock, Becker ou Fichte, il s’agit donc de formuler les principes capables de justifier la propriété des auteurs sur leurs écrits indépendamment des privilèges octroyés par les princes ou les villes, et, du coup, de faire reconnaître la rémunération des auteurs par leurs éditeurs, non pas comme une faveur ou une grâce, mais comme une juste rétribution du travail de l’écriture.
La double nature du livre. Objet et discours
Mais il est une autre raison à la question que Kant pose dans la Doctrine du droit de la Métaphysique des mœurs – une question paradoxale puisque l’objet la « doctrine philosophique du droit » est d’établir des principes universels a priori qui font abstraction des cas particuliers. Si Kant en vient à considérer justement un cas particulier, le livre, c’est parce que celui-ci pose un problème spécifique au sein de la classe des contrats. Comme « produit matériel », comme un « opus mechanicum », le livre est l’objet d’un droit réel, défini comme le droit sur une chose qui en autorise un usage privé partagé par tous ceux qui sont en possession de cette même chose - ainsi les acheteurs des différents exemplaires d’une édition. Mais le livre est aussi un discours, donc l’objet d’un droit personnel qui justifie une propriété unique et exclusive. Il peut donc être l’objet d’un contrat de procuration autorisant la gestion d’un bien au nom d’un autre sans que soit pour autant aliénée la propriété de son possesseur. Le libraire agit seulement au nom de l’auteur, dont la propriété n’est pas transférée. Se trouvent ainsi fondées, tout ensemble, l’illégitimité des reproductions faites aux dépens du libraire éditeur qui a reçu mandat de l’auteur et le droit personnel de l’auteur, un droit unique et exclusif, inaliénable et imprescriptible, qui prévaut sur le droit réel attaché à l’objet devenu propriété de son acheteur. La reproduction d’un discours n’est légitime que si elle est fondée juridiquement sur un mandat donné par l’auteur; à l’inverse, la propriété d’un exemplaire de ce discours, légitime du point de vue du droit réel, est insuffisante pour justifier sa reproduction.
Le livre est donc, à la fois, un bien matériel dont l’acheteur devient le légitime propriétaire et un discours dont l’auteur conserve la propriété « nonobstant la reproduction » comme écrit Kant. En ce second sens, le livre est entendu comme une œuvre qui transcende toutes ses possibles matérialisations. Selon Blackstone, avocat de la cause des libraires londoniens menacés en 1710 dans leur revendication d’un copyright perpétuel et patrimonial sur les titres qu’ils avaient acquis par une nouvelle législation qui limitait leur propriété à quatorze ans, « l’identité d’une composition littéraire réside entièrement dans le sentiment et le langage ; les mêmes conceptions, habillées dans les mêmes mots, constituent nécessairement une même composition : et quelle que soit la modalité choisie pour transmettre une telle composition à l’oreille ou à l’œil, par la récitation, l’écriture, ou l’imprimé, quel que soit le nombre de ses exemplaires ou à quelque moment que ce soit, c’est toujours la même œuvre de l’auteur qui est ainsi transmise ; et personne ne peut avoir le droit de la transmettre ou transférer sans son consentement, soit tacite soit expressément donné »[2].
Forme et idées.
Lors du débat mené en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle sur la contrefaçon des livres, Fichte énonce de manière neuve la double nature du livre[3]. À la dichotomie classique entre les deux natures, corporelle et spirituelle, du livre, qui sépare le texte de l’objet, il en ajoute une seconde qui distingue dans toute œuvre les idées qu’elle exprime et la forme qui leur est donnée par l’écriture. Les idées sont universelles par leur nature, leur destination et leur utilité: elles ne peuvent donc justifier aucune appropriation personnelle. Celle-ci est légitime seulement parce que « chacun a son propre cours d’idées, sa façon particulière de se faire des concepts et de les lier les uns aux autres ». « Comme des idées pures sans images sensibles ne se laissent non seulement pas penser, d’autant moins présenter à d’autres, il faut bien que tout écrivain donne à ses pensées une certaine forme, et il ne peut leur en donner aucune autre que la sienne propre, car il n’en a pas d’autres »; de là, découle que « personne ne peut s’approprier ses pensées sans en changer la forme. Aussi celle-ci demeure-t-elle pour toujours sa propriété exclusive». La singularité de l’écriture est donc l’unique mais puissante justification de l’appropriation des discours telles que les transmettent les objets imprimés. Une telle propriété a un caractère tout à fait particulier puisque, étant inaliénable, elle demeure indisponible, et celui qui l’acquiert (par exemple un libraire) ne peut en être que l’usufruitier ou le représentant, obligé par toute une série de contraintes – ainsi la limitation du tirage de chaque édition ou le paiement d’un droit pour toute réédition. Les distinctions conceptuelles construites par Fichte doivent donc permettre de protéger les éditeurs contre les contrefaçons sans entamer en rien la propriété souveraine et permanente des auteurs sur leurs œuvres. Ainsi, paradoxalement, pour que les textes puissent être soumis au régime de propriété qui était celui des choses, il fallait qu’ils fussent conceptuellement détachés de toute matérialité particulière.
Corps et âme
Avant les formulations philosophiques et juridiques du XVIIIe siècle, c’est dans le recours aux métaphores que pouvait être énoncée la double nature du livre. Alonso Víctor de Paredes, imprimeur à Madrid et Séville et auteur du premier manuel sur l’art d’imprimer en langue vulgaire, intitulé Institución del Arte de la Imprenta y Reglas generales para los componedores, composé vers 1680, exprime avec force et subtilité cette double nature du livre, comme objet et comme œuvre[4]. Il inverse la métaphore classique qui décrit les corps et les visages comme des livres et tient le livre pour une créature humaine parce que, comme l’homme, il a un corps et une âme: « J’assimile un livre à la fabrication d’un homme, qui a une âme rationnelle, avec laquelle Notre Seigneur l’a créé avec toutes les grâces que sa Majesté Divine a voulu lui donner ; et avec la même toute-puissance il a formé son corps élégant, beau et harmonieux ».
Si le livre peut être comparé à l’homme, c’est parce que Dieu a créé la créature humaine de la même manière que l’est un ouvrage qui sort des presses. Dans un mémoire publié en 1675 pour justifier les privilèges fiscaux des imprimeurs madrilènes, un avocat, Melchor de Cabrera, a donné sa forme la plus élaborée à la comparaison en dressant l’inventaire des six livres écrits par Dieu[5]. Les cinq premiers sont le Ciel étoilé, comparé à un immense parchemin dont les astres sont l’alphabet ; le Monde, qui est la somme et la carte de l’entière Création ; la Vie, identifié à un registre contenant les noms de tous les élus ; le Christ lui-même, qui est à la fois « exemplum » et « exemplar », exemple proposé à tous les hommes et exemplaire de référence que doit copier l’humanité ; la Vierge, enfin, le premier de tous les livres, dont la création dans l’Esprit de Dieu a préexisté à celle du Monde et des siècles. Parmi les livres de Dieu, que Cabrera réfère à l’un ou l’autre des objets de la culture écrite de son temps, l’homme fait exception car il résulte du travail de Dieu imprimeur : « Dieu mit sur la presse son image et empreinte, pour que la copie sortît conformément à la forme qu’elle devait avoir [...] et il voulut en même temps être réjoui par les copies si nombreuses et si variées de son mystérieux original ».
Paredes reprend l’image du livre comparée à la créature humaine. Mais, pour lui, l’âme du livre n’est pas seulement le texte tel qu’il a été composé, dicté, imaginé par son créateur. Elle est ce texte donné dans une disposition adéquate, « una acertada disposición »: « un livre parfaitement achevé consiste en une bonne doctrine, présentée comme il le faut grâce à l’imprimeur et au correcteur, c’est cela que je tiens pour l’âme du livre ; et c’est une bonne impression sur la presse, propre et soignée, qui fait que je peux le comparer à un corps gracieux et élégant ». Si le corps du livre est le résultat du travail des pressiers, son « âme » n’est pas façonnée seulement par l’auteur, mais elle reçoit sa forme de tous ceux, maître imprimeur, compositeurs et correcteurs, qui prennent soin de la ponctuation, de l’orthographe et de la mise en page. Paredes récuse ainsi par avance toute séparation entre la substance essentielle de l’œuvre, tenue pour toujours identique à elle-même, quelle que soit sa forme, et les variations accidentelles du texte, qui résultent des opérations dans l’atelier. Il refuse toute dichotomie entre « substantives » et « accidentals », pour reprendre les termes de la bibliographie matérielle, entre le texte dans sa permanence immatérielle et les altérations infligées par les préférences, les habitudes ou les erreurs de ceux qui l'ont composé et corrigé. Pour lui, la matérialité du texte et la textualité du livre sont inséparables.
La main de l’auteur
Exprimée dans répertoire des métaphores chrétiennes au Siècle d’Or ou formulée dans les catégories philosophiques ou juridiques des Lumières, la double nature du livre nous ramène au texte de Kant. En tenant l’imprimerie comme une nouvelle forme d’écriture et une édition comme la somme de toutes les copies de l’ « original », Kant inscrit sa réflexion dans le nouveau paradigme de l’écriture et le nouvel ordre des discours qui, depuis la mi-XVIIIe siècle, associe les catégories d’individualité, d’originalité et de propriété. Le manuscrit de l’auteur devient ainsi le garant du discours qu’il adresse au public par l’intermédiaire de son mandataire, le libraire éditeur, alors qu’au XVIe et XVIIe siècle en Espagne, le même mot, « original », désignait la copie au propre, établie par un scribe professionnel, qui était transmise aux censeurs pour approbation puis aux maîtres imprimeurs pour l’impression. Dès lors que l’œuvre est pensée comme immatérielle, toujours identique à elle-même quelles que soient ses formes imprimées, qui n’en sont que des « représentations », comme affirme Kant, le manuscrit original, écrit de la main même de l’auteur, en vient à attester le droit personnel de l’écrivain sur son discours, un droit jamais détruit par le droit réel des acheteurs des livres qui font circuler l’œuvre. Devenu le signe visible d’une œuvre immatérielle, le manuscrit de l’auteur doit être conservé, respecté et révéré.
Cette nouvelle configuration conceptuelle explique pourquoi en Europe ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle que les manuscrits d’auteurs existent en nombre. Ils sont aujourd’hui conservés soit dans les bibliothèques ou archives nationales, soit dans les archives littéraires qui ont été rassemblées à Marbach dans la Deutsches Literaturarchiv, à Reading dans la collection des « Author’s Papers » des Special Collections de la bibliothèque de l’université, à Milan par Apice, ou en France par l’Institu Mémoire de l’Edition Contemporaine. A suivre l’exemple français, si les manuscrits d’auteurs ne sont pas rares après 1750 (ils existent pour La Nouvelle Héloïse, Les liaisons dangereuses, Paul et Virginie, ou les Dialogues ou Rousseau juge de Jean Jacques dont Rousseau fit quatre copies autographes), il n’en va pas de même pour les œuvres écrites antérieurement. Seules des circonstances exceptionnelles expliquent la conservation des fragments autographes des Pensées que Pascal rassemblait dans des liasses mais qui ont été collés et réorganisés sur les pages d’un cahier au XVIIIe siècle, ce qui rend difficile de les considérer comme le manuscrit original de l’œuvre, ou bien les corrections et additions de Montaigne aux Essais qui n’ont subsisté que parce qu’il les a portées sur un exemplaire de l’édition de 1588, le fameux « exemplaire de Bordeaux »[6].
La seule véritable exception à cette rareté des manuscrits d’auteur avant la mi-XVIIIe siècle est donnée par les manuscrits de théâtre, tant en Espagne qu’en Angleterre. Mais doit-on considérer ces manuscrits autographes des dramaturges de la première modernité comme semblables à ceux laissés par les écrivains des XIXe et XXe siècles ? Sans doute pas, si l’on pense qu’ils ont été souvent utilisés comme des livres de régie ou « prompt books » destinés à organiser les représentations et comme des documents enregistrant l’autorisation de représenter la pièce, ou bien comme des exemplaires présentés à leurs protecteurs, ce qui les situe, paradoxalement peut-être, au sein des copies établies par les scribes professionnels. En ce sens, les auteurs des XVIe et XVIIe siècles doivent être considérés comme des copistes d’eux-mêmes et leurs manuscrits considérés, non pas comme les traces du processus d’écriture, objet privilégié de la critique génétique, mais comme des copies de l’œuvre.
Le rôle décisif des copistes dans le procès de publication est justement l’une des raisons de la disparition des manuscrits d’auteur avant la mi-XVIIIe siècle[7]. Comme le montre l’exemple de l’Espagne du Siècle d’Or, les manuscrits autographes n’étaient jamais utilisés par les typographes qui composaient avec les caractères mobiles les pages du livre à venir. La copie qu’ils utilisaient était le texte mis au propre par un scribe professionnel qui avait été envoyé au Conseil du Roi pour recevoir les approbations des censeurs, puis la permission d’imprimer et le privilège du souverain. Rendu à l’auteur ou au libraire éditeur, c’est ce manuscrit qui était remis au maître imprimeur et à ses ouvriers. Mis en forme par un copiste professionnel puis préparé par un correcteur pour la composition et l’impression dans l’atelier typographique, le manuscrit original de l’auteur perdait toute importance et il était détruit, tout comme l’était généralement la copie utilisée dans l’imprimerie après l’impression du texte. Sans importance, le manuscrit original n’était conservé par personne, pas même par l’écrivain[8].
Il n’en va plus de même à partir du XVIIIe siècle. La fétichisation de la main de l’auteur, de la signature authentique, du manuscrit autographe deviennent alors la plus forte conséquence de la dématérialisation des œuvres dont l’identité est située dans l’inspiration créatrice de l’écrivain, sa manière de lier les idées ou d’exprimer les sentiments de son cœur. La main de l’auteur est désormais garante de l’authenticité de l’œuvre dispersée entre les multiples livres qui la diffusent auprès de ses lecteurs. Elle est l’unique témoignage matériel du génie immatériel de l’écrivain. De ce fait, lorsque l’autographe n’existe pas, il faut l’inventer. De là, la prolifération des falsifications dont les plus spectaculaires sont celles des manuscrits shakespeariens[9]. De là, également, la constitution, à la fin du XVIIIe siècle, d’un marché des manuscrits littéraires, qu’ils soient de la main d’un auteur ou de celle d’un copiste, et le développement des collections de signatures autographes.
L’œuvre et la vie
La forte relation entre manuscrit autographe et authenticité de l’œuvre a été intériorisée par certains écrivains qui, avant Flaubert ou Hugo, se sont faits les archivistes d’eux-mêmes. C’est le cas pour Rousseau qui conserva pour La Nouvelle Héloïse ses brouillons, quatre copies de sa main et des exemplaires annotés de trois éditions, constituant ainsi un dossier génétique de plusieurs milliers de pages[10]. C’est le cas de Goethe qui se préoccupa de la conservation de ses manuscrits, lettres et collections et qui intitula l’un de ses essais “les archives du poète et de l’écrivain”[11]. Dans les deux cas, le souci d’une édition complète des œuvres a pu guider ce souci d’archives, mais plus encore une intense relation personnelle avec l’écriture qui ne détache pas les écrits, même publiés, de la main de l’écrivain.
L’existence d’archives littéraires composées par les auteurs eux-mêmes a de profondes conséquences sur la délimitation même de l’ « œuvre ». On sait, pour les temps contemporains, comment Borges manipula le contenu canonique de son œuvre, excluant trois livres écrits entre 1925 et 1928 (Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza et El idioma de los Argentinos) et choisissant avec son éditeur et traducteur français, Jean-Pierre Bernés, les textes qui devaient la constituer, incluant alors des comptes rendus de livres et de films, des chroniques et des articles jusque là maintenus hors des frontières des Obras completas[12]. On connaît, aussi, les discussions à propos des limites de l’œuvre de Nietzsche, situées entre la « prolifération » plaisamment suggérée par Foucault, incluant éventuellement dans l’œuvre les indications d’un rendez-vous ou d’une adresse, ou une note de blanchisserie qui seraient trouvées dans un carnet d’aphorismes, et sa « raréfaction » proposée par Mazzino Montinari, qui exclut de l’œuvre son livre le plus fameux, La Volonté de puissance, composé comme tel, non par Nietzsche, mais par sa sœur Elisabeth à partir de notes, esquisses et réflexions laissées par son frère sans intention d’en faire un livre[13].
Mais plus encore que ces redéfinitions des contours de l’œuvre, la présence des archives littéraires et la configuration conceptuelle qui les a rendues possibles, ou necessaires ont imposé une manière nouvelle de lier la production littéraire et la vie de l’auteur. A partir de la mi-XVIIIe siècle, les compositions littéraires ne sont plus pensées comme fondées sur le réemploi d’histoires déjà écrites, les citations de lieux communs, partagés parce que sublimes, ou les collaborations exigées par les protecteurs ou les entrepreneurs de théâtre. Elles sont désormais conçues comme des créations originales qui expriment les pensées ou les sentiments les plus intimes de l’individu et qui se nouent avec ses expériences les plus personnelles. La première conséquence de cette mutation fut le désir de publier les œuvres d’un même auteur en respectant la chronologie de leur composition, afin de saisir le déploiement de son génie ; la seconde fut l’écriture de biographies littéraires.
Pour Shakespeare, Edmond Malone fut le premier à la fin du XVIIIe siècle à associer les deux projets[14]. Il fonda sa Life of Shakespeare sur la recherche de documents authentiques et il proposa la première chronologie des œuvres de Shakespeare, appelant ainsi à rompre avec la distribution des pièces entre comédies, histoires et tragédies, durablement héritée du Folio de 1613. Mais la tâche n’était pas aisée en l’absence de tout document autographe laissé par Shakespeare (à l’exception de six signatures, dont trois dans son testament dicté à un notaire) et du petit nombre de documents qui le mentionnaient. Elle exigeait de recourir au seul procédé disponible pour écrire les biographies des auteurs sans archives : situer les œuvres à l’intérieur de la vie suppose de retrouver la vie dans les œuvres elles-mêmes.
Les difficultés posées par ce cercle vicieux sont un heureux rappel des effets pervers produits par l’utilisation rétrospective d’un paradigme de l’écriture constitué seulement au XVIIIe siècle qui impose des catégories anachroniques à des textes composés dans un régime de production et circulation textuelles tout différent. C’est à l’intérieur de ce paradigme que Kant répond à la question « Qu’est-ce qu’un livre ? », présupposant implicitement que ce sont les auteurs qui font les livres et que ces livres ne sont que la matérialisation d’une œuvre idéale, qui n’existe dans sa forme plus achevée que dans l’esprit de son créateur et dont le manuscrit autographe est la moins imparfaite des représentations.
Relier et disséminer
Pour Kant, donc, ce sont les auteurs qui font les livres. Mais ne peut-on pas inverser la proposition et penser que dans de nombreux cas, ce sont les livres qui font les auteurs en rassemblant dans un même objet des textes dispersés qui, reliés ensemble, deviennent une « œuvre »? Le cas de Shakespeare est exemplaire de ce processus. Durant sa vie, aucun des poèmes, aucune des pièces qu’il écrivit ne circula comme livre. Publiés très généralement dans le format in-quarto, les uns et les autres étaient ce que les règlements de la communauté des libraires et imprimeurs de Londres définissaient comme des « pamphlets », c’est-à-dire des brochures non reliées.
Ce sont les libraires éditeurs qui inventèrent le corpus shakespearien, rendu visible par la matérialité même du livre qui en rassemble les pièces. Après le projet inabouti de Thomas Pavier qui commença en 1619, trois ans après la mort de Shakespeare, une collection de ses pièces destinée à un volume unique[15], le livre qui fit Shakespeare ou, du moins, son œuvre, est le Folio de 1623, édité par deux de ses anciens compagnons de troupe, Heminges et Condell, et publié par un consortium de quatre libraires londoniens[16]. L’entreprise supposait deux opérations, qui sont celles-là même désignées par Foucault comme constitutives de la fonction-auteur[17]. D’abord, la délimitation du corpus lui-même, à partir de deux exclusions : celle des poèmes, qui était la plus paradoxale puisqu’ils étaient les œuvres de Shakespeare qui avaient rencontré les plus grands succès de librairie (avec neuf éditions de Venus et Adonis et quatre du Viol de Lucrèce) et celles dont l’attribution était la plus explicite, et celle des pièces que Heminges et Condell savaient avoir été écrites en collaboration.
La seconde opération nécessaire pour que le livre fasse l’auteur résidait dans la justification de l’authenticité shakespearienne des pièces réunies dans une même reliure. Elle supposait la construction d’une fiction : celle de l’impression des textes à partir des « true original copies » laissées par l’auteur. L’adjectif « original » renvoie à la main de l’auteur, mais, à la différence des exigences du XVIIIe siècle, celle-ci n’a pas à être montrée puisque, affirment Heminges et Condell, « son esprit et sa main allaient ensemble. Et ce qu’il concevait, il l’énonçait avec une telle aisance, que nous n’avons que très rarement rencontré une rature dans ses manuscrits »[18]. Ainsi, que la copie originale soit le manuscrit autographe ou une copie mise au propre par un scribe n’importait guère. En lisant les textes rassemblés dans le Folio, qui publient les « writings » de l’auteur, le lecteur lira, en fait, son « handwriting », ce qu’il a écrit de sa propre main. Dans sa matérialité même, le livre fait l’auteur ou, mieux, est l’auteur lui-même.
Si les livres font les œuvres et les auteurs, ils peuvent aussi contribuer à leur démembrement. Il en alla ainsi avec les poèmes et pièces de Shakespeare, présentes sous forme de citations dans des recueils imprimés de lieux communs dès 1600[19]. Le Bel-vedere or, The Garden of Muses, qui est le premier recueil de lieux communs entièrement composé de citations d’écrivains du temps, comprend cent soixante dix-neuf citations de Shakespeare, quatre-vingt-onze extraites du Viol de Lucrèce et quatre-vingt-huit de cinq de ses pièces. Les citations sont anonymes (mais les noms des vingt-cinq auteurs utilisés sont donnés au début de l’ouvrage), limitées à une ou deux lignes et distribuées entre des rubriques thématiques. Dans la même année 1600, l’Englands Parnassus, autre recueil de lieux communs, fait également la part belle à Shakespeare avec trente citations de cinq pièces, vingt-six tirées de Venus et Adonis et trente-neuf du Viol de Lucrèce. Les citations sont plus longues, composées de plusieurs vers, et elles sont attribuées à leurs auteurs. Elles deviennent ainsi des citations de Shakespeare, totalement détachées de l’intrigue dramatique et des personnages qui les prononcent puisque leur raison d’être réside dans la vérité universelle qu’elles énoncent. Le livre de lieux communs, composé à partir de la fragmentation d’autres livres déjà publiés, est ainsi un livre de la sagesse et du savoir universels.
Dans le cas des romans, à commencer par Don Quichotte, la dissémination du texte hors le livre prend d’autres formes et, en particulier, celle d’éditions abrégées de l’histoire. La contraction souvent drastique des épisodes du récit et la transformation des dialogues illustrent la volonté de réduire ou fragmenter les œuvres de manière à les faire circuler sous forme d’extraits ou d’abrégés. De tels raccourcissements ne sont pas seulement le fait d’éditeurs soucieux des impatiences du public, mais sous une autre forme, ils furent inaugurés par les auteurs eux-mêmes. C’est ainsi que Richardson, s’il condamne les versions abrégées de ses romans, propose lui-même des anthologies rassemblant leurs leçons morales sous la forme de recueils de lieux communs, puisque les extraits sont presentés comme « digested under proper heads », « digérés entre les rubriques adéquates ». Les enseignements des romans sont ainsi détachés de la trame narrative et formulés comme des verities universelles rangées dans l’ordre alphabétique des notions qui les désignent.
Codex, rouleau, écran
Cette tension dissemination et rassemblement nous ramène à notre question initiale, « Qu’est-ce qu’un livre » et oblige entre à replacer le livre imprimé dans une plus longue durée. En dépit du titre de l’ouvrage justement célèbre de Lucien Febvre et Henri-Jean Martin[20], le livre, notre livre, fait de feuillets et de pages, n’apparaît pas avec l’imprimerie. Il faut donc prendre garde à ne pas attribuer à la presse et aux caractères mobiles des innovations textuelles (index, tables, concordances, foliotation, pagination) ou des usages qui ont accompagné, plus de dix siècles auparavant, l’invention qui les a rendu possibles: celle du “codex”. En substituant au rouleau une forme nouvelle de livre, cette première révolution a permis des rapports à l’écrit qui étaient tout à fait impossible auparavant: par exemple, feuilleter ou indexer un texte.[21]. C’est entre le IIe et le IVe siècle que s’impose la nouvelle forme de livre dont héritera l’imprimerie et que se constitue le socle de la sédimentation historique de très longue durée qui, jusqu’à la révolution numérique, définissait tout ensemble l’ordre des discours et celui des livres.
Si l’apparition du « codex » en est le premier héritage, une seconde rupture se situe aux XIVe et XVe siècles, avant l’invention de Gutenberg, et consiste en l’apparition du « libro unitario », selon l’expression d’Armando Petrucci. Celui-ci rassemble dans une même reliure les œuvres d’un seul auteur, voire, même, une seule œuvre[22]. Si cette réalité matérielle était la règle pour les corpus juridiques, les œuvres canoniques de la tradition chrétienne ou les classiques de l’Antiquité, il n’en allait pas de même pour les textes en vulgaire qui, généralement, se trouvaient réunis dans des miscellanées contenant destextes fort divers. C’est autour de figures comme Pétrarque ou Boccace, Christine de Pisan ou René d’Anjou, que naît, pour les écrivains “modernes”, le livre « unitaire », c’est-à-dire un livre où se noue le lien entre l’objet matériel, l’œuvre (au sens d’une œuvre particulière ou d’une série d’œuvres) et l’auteur.
Le troisième temps de l’histoire longue qui lie objet, œuvre et livre est, évidemment, l’invention de la presse à imprimer et des caractères mobiles à la mi-XVe siècle. À partir de ce moment-là, sans qu’elle fasse disparaître, tant s’en faut, la publication manuscrite, l’imprimerie devient la technique la plus utilisée pour la reproduction de l’écrit et la production des livres.
Nous sommes les héritiers de ces trois histoires. D’abord, pour la définition du livre, qui est pour nous, tout à la fois, un objet différent des autres objets de la culture écrite et une œuvre intellectuelle ou esthétique dotée d’une identité et d’une cohérence assignées à son auteur. Ensuite, et plus largement, pour une perception de la culture écrite fondée sur les distinctions immédiates, matérielles, entre des objets qui portent des genres textuels différents et qui impliquent des usages différents.
La textualité numérique
C’est un tel ordre des discours que met en question la textualité électronique.[23] Le temps present est celui de la constitution de collections électroniques permettant l’accès à distance des fonds conservés dans les bibliothèques. Bien fou serait celui qui jugerait inutile ou dangereuse cette extraordinaire possibilité offerte à l’humanité. Tous les livres pour chaque lecteur, où qu’il soit : le rêve est magnifique, promettant un accès universel aux savoirs et à la beauté. Toutefois, il ne doit pas faire perdre raison. Certes, le transfert du patrimoine écrit d’une matérialité à une autre n’est pas sans précédents. Au quinzième siècle, la nouvelle technique de reproduction des textes fut mise massivement au service des genres qui dominaient la culture du manuscrit : manuels de la scolastique, livres liturgiques, compilations encyclopédiques, calendriers et prophéties. Dans les premiers siècles de l’ère chrétienne, l’invention du livre qui est encore le nôtre, le codex, avec ses feuillets, ses pages et ses index, accueillit dans un nouvel objet les Ecritures sacrées et les œuvres des auteurs grecs et latins.
L’histoire n’enseigne rien, malgré le lieu commun qui lui attribue des leçons, mais dans ces deux cas, elle montre un fait essentiel pour comprendre le présent, à savoir, qu’un « même » texte n’est plus le même lorsque changent la matérialité de son inscription, donc, également, les manières de le lire et le sens que lui attribuent ses nouveaux lecteurs. La lecture du rouleau dans l’Antiquité supposait une lecture continue, elle mobilisait tout le corps puisque le lecteur devait tenir l’objet écrit à deux mains et elle interdisait d’écrire durant la lecture[24]. Le codex, manuscrit puis imprimé, a permis des gestes inédits. Le lecteur peut feuilleter le livre, désormais organisé à partir de cahiers, feuillets et pages, et il lui est possible d’écrire en lisant. Le livre peut être paginé et indexé, ce qui permet de citer précisément et de retrouver aisément tel ou tel passage[25]. La lecture ainsi favorisée est une lecture discontinue mais pour laquelle la perception globale de l’œuvre, imposée par la matérialité même de l’objet, est toujours présente.
Les bibliothèques le savent, même si certaines d’entre elles ont pu avoir, ou ont encore la tentation de reléguer loin des lecteurs, voire de détruire, les objets imprimés dont la conservation semblait assurée par le transfert sur un autre support: le microfilm et la microfiche d’abord, le fichier numérique aujourd’hui[26]. Contre cette mauvaise politique, il faut rappeler que protéger, cataloguer et rendre accessibles les textes dans les formes successives ou concurrentes qui furent celles où les ont lus leurs lecteurs du passé, et d’un passé même récent, demeure une tâche fondamentale des bibliothèques – et la justification première de leur existence comme institution de conservation et lieu de lecture. À supposer que les problèmes techniques et financiers de la numérisation soient résolus et que tout le patrimoine écrit puisse être converti sous une forme numérique, la conservation et la communication de ses supports antérieurs n’en seraient pas moins nécessaires. Sinon, la félicité promise par cette bibliothèque d’Alexandrie enfin réalisée se paierait du prix de l’amnésie des passés qui font que les sociétés sont ce qu’elles sont.
Et ce, d’autant plus que la numérisation des objets de la culture écrite qui est encore la nôtre (le livre, la revue, le journal) leur impose une mutation bien plus forte que celle impliquée par la migration des textes du rouleau au codex. L’essentiel ici me paraît être la profonde transformation de la relation entre le fragment et la totalité. Au moins jusqu’à aujourd’hui, dans le monde électronique, c’est la même surface illuminée de l’écran de l’ordinateur qui donne à lire les textes, tous les textes, quels que soient leurs genres ou leurs fonctions. Est ainsi rompue la relation qui, dans toutes les cultures écrites antérieures, liait étroitement des objets, des genres et des usages. C’est cette relation qui organise encore les différences immédiatement perçues entre les différents types de publications imprimées et les attentes de leurs lecteurs, guidés dans l’ordre ou le désordre des discours par la matérialité même des objets qui les portent. Et c’est cette relation, enfin, qui rend visible la cohérence des œuvres, imposant la perception de l’entité textuelle, même à celui ou celle qui n’en veut lire que quelques pages. Il n’en va plus de même dans le monde de la textualité numérique puisque les discours ne sont plus inscrits dans des objets qui permettent de les classer, hiérarchiser et reconnaître dans leur identité propre. Le monde numérique est un monde de fragments décontextualisés, juxtaposés, indéfiniment recomposables, sans que soit nécessaire ou désirée la compréhension de la relation qui les inscrit dans l’œuvre dont ils ont été extraits.
On objectera qu’il en a toujours été ainsi dans la culture écrite, largement et durablement construite à partir de recueils d’extraits, d’anthologies de lieux communs (au sens noble de la Renaissance[27]), de morceaux choisis. Certes. Mais, dans la culture de l’imprimé, le démembrement des écrits est accompagné de son contraire: leur circulation dans des formes qui respectent leur intégrité et qui, parfois, les rassemblent dans des « œuvres », complètes ou non. De plus, dans le livre d’extraits lui-même les fragments sont nécessairement, matériellement, rapportés à une totalité textuelle, reconnaissable comme telle.
Plusieurs conséquences découlent de cette différence fondamentale. L’idée même de revue devient incertaine lorsque la consultation des articles n’est plus liée à la perception immédiate d’une logique éditoriale rendue visible par la composition de chaque numéro, mais est organisée à partir d’un ordre thématique de rubriques. Et il est sûr que les nouvelles manières de lire, discontinues et segmentées, mettent à mal les catégories qui régissaient le rapport aux textes et aux œuvres, désignées, pensées et appropriées dans leur singularité et cohérence.
Ecriture et edition numériques
L’obsession, peut-être excessive et indiscriminée, pour la numérisation ne doit pas masquer un autre aspect de la « grande conversion numérique », pour reprendre l’expression de Milad Doueihi[28], à savoir, la capacité de la nouvelle technique à porter des formes d’écriture originales, libérées des contraintes imposées, à la fois, par la morphologie du codex et le régime juridique du copyright. Cette écriture polyphonique et palimpseste, ouverte et malléable, infinie et mouvante, bouscule les catégories qui, depuis le dix-huitième siècle, sont le fondement de la propriété littéraire et elle prend place dans un univers où ce sont les notions mêmes d’écriture, de sociabilité ou d’identité qui se trouvent redéfinies[29].
Comme l’indique Antonio Rodríguez de las Heras[30], dans l’espace numérique ce n’est pas l’objet écrit qui est plié, comme dans le cas de la feuille du livre manuscrit ou imprimé, mais le texte lui-même. La lecture consiste donc à « déplier » cette textualité mobile et infinie. Une telle lecture constitue sur l’écran des unités textuelles éphémères, multiples et singulières, composées à la volonté du lecteur, qui ne sont en rien des pages définies une fois pour toutes. Cette nouvelle manière de lire, segmentée, fragmentée, discontinue, qui défie profondément la perception des livres comme œuvres, des textes comme des créations singulières et originales, toujours identiques à elles-mêmes et, pour cette raison même, propriété de leur auteur. Les nouvelles productions écrites, d’emblée numériques, posent dès maintenant la difficile question de leur archivage et conservation. Les bibliothèques doivent y être attentives, au momen où elles développent la numérisation de leur patrimoine, tout comme les éditeurs, confrontés aux differences entre les livres numérisés, qui ont ou ont eu aussi une existence imprimée, et les objets numériques, composés selon les logiques et resources propres à la publication électronique[31]. Ce qui est en jeu est la construction d’un nouvel ordre des discours où se croisent, pour s’opposer ou s’associer, concepts hérités et possibilités inédites.
La tension entre la conception ancienne des œuvres et les modalités numériques de leur lecture est particulièrement aiguë pour les plus jeunes générations de lecteurs qui sont entrés dans la culture écrite face à l'écran de l'ordinateur. Leur pratique de lecture, très immédiatement et spontanément habituée à la fragmentation des textes, quels qu'ils soient, heurte de front les catégories forgées à partir du XVIIIe siècle pour définir les œuvres à partir de leur singularité et de leur totalité. L'enjeu n'est pas mince. Il peut conduire soit à la possible introduction dans la textualité numérique de dispositifs capables de perpétuer les critères classiques de définition et perception des œuvres, qui sont ceux-là mêmes qui fondent la propriété littéraire, soit à l'abandon de ces critères au profit d'une nouvelle manière de percevoir et penser l'écrit, tenu pour un discours continu dont le lecteur découpe et recompose les éléments en toute liberté.
Lequel de ces deux possibles futurs deviendra réalité ? L’histoire ne donne pas la réponse. La seule compétence des historiens, piètres prophètes, est de rappeler que, dans la longue durée de la culture écrite, chaque mutation (l’apparition du codex, l’invention de l’imprimerie, les révolutions de la lecture, la lecture à haute voix au temps de la lecture visuelle et silencieuse) a toujours produit une coexistence originale entre les gestes du passé et les nouvelles techniques. À chaque fois, la culture écrite a conféré des rôles inédits aux objets et aux pratiques anciennes : le rouleau au temps du codex, la publication manuscrite à l’âge de l’imprimé. C’est une telle réorganisation de la culture écrite que la révolution du présent impose et il est loisible de supposer que, comme dans le passé, les écrits se redistribueront entre les objets anciens et les supports nouveaux qui permettent de les inscrire, de les publier et de les transmettre.
Demeure, toutefois, le fait inédit de la dissociation, voire, de la contradiction entre les catégories qui ont fondé un ordre du discours sur le nom d’auteur, l’identité perpétuées des œuvres et la propriété intellectuelle, et, d’autre part, la radicale mise en question de ces notions par les pratiques du monde numérique. Ces sont ces pratiques, disséminées, silencieuses, anonymes, bien plus que les discours (même celui-ci) qui dessinent le futur de la culture écrite.
[1] Kant, “Qu’est qu’un livre ?”, dans Emmanuel Kant, Qu’est-ce qu’un livre ? Textes de Kant et de Fichte, Jocelyn Benoist (ed.), Paris, Presses Universitaires de France, 1995, pp. 133–135.
[2] William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Oxford, 1765–1769, cité par Mark Rose, Authors and Owners. The Invention of Copyright, Cambridge, Mass., et Londres, Harvard University Press, 1993, p. 89–90.
[3] Johann Gottlieb Fichte, Beweis der Unrechtmässigkeit der Büchernadrucks. Ein Räsonnement und eine Parabel, 1791 [traduction française Fichte, “Preuve de l’illégitimité de la reproduction des livres, un raisonnement et une parabole”, dans Emmanuel Kant, Qu’est-ce qu’un livre ? Textes de Kant et de Fichte, op. cit., pp. 139–170, citations, pp. 145–146. Ce texte est commenté par Martha Woodmansee, The Author, Art, and the Market. Rereading the History of Aesthetics, New York, Columbia University Press, 1994, pp. 51–53.
[4] Alonso Víctor de Paredes, Institución y Origen del Arte de la Imprenta y Reglas generales para los componedores, Jaime Moll (ed.), Madrid, El Crotalón, 1984 (reed. Madrid, Calambur, Biblioteca Litterae, 2002, avec une “Nueva noticia editorial” de Víctor Infantes).
[5] Melchor de Cabrera Nuñez de Guzman, Discurso legal, histórico y político en prueba del origen, progressos, utilidad, nobleza y excelencias del Arte de la Imprenta ; y de que se le deben (y a sus Artifices) todas las Honras, Exempciones, Inmunidades, Franquezas y Privilegios de Arte Liberal, por ser, como es, Arte de las Artes, Madrid, 1675.
[6] Brouillons d’écrivains, sous la direction de Marie-Odile Germain and Danièle Thibault, Paris Bibliothèque Nationale de France, 2001.
[7] Luciano Canfora, Il copista como autore, Palerme, Sellerio, 2002, tr. Fr. Le copiste comme auteur, Toulouse, Anacharsis, 2012.
[8] Pablo Andrés Escapa and al., « El original de imprenta » and Sonia Garza Merino, « La cuenta del orignal », in Imprenta y crítica textual en el Siglo de Oro, Estudios publicados bajo la dirección de Francisco Rico, Valladolid, Centro para le Edición de los Clásicos Españoles, 2000, pp. 29–64 and pp. 65–95, et Francisco Rico, El texto del « Quijote ». Preliminares a una ecdótica del Siglo de Oro, Barcelona, Ediciones Destino, 2006, pp. 55–93.
[9] Patricia Pierce, The Great Shakespeare Fraud : The Strange, True Story of William-Henry Ireland, Stroud, Sutton, 2004, and The Confessions of William Henry Ireland : containing the particulars of his fabrication of the Shakspeare manuscripts ; together with anecdotes and opinions (hitherto unpublished) of many distinguished persons in the literary, political, and theatrical world, London : Printed by Ellerton and Byworth for T. Goddard, 1805.
[10] Nathalie Ferrand, « J.-J. Rousseau, du copiste à l’écrivain. Les manuscrits de la Nouvelle Héloïse conservés à la Bibliothèque de l’Assemblée Nationale », in Êcrire aux XVIIe et XVIIIe siècles. Genèse de textes littéraires et philosophiques, sous la direction de Jean-Louis Lebrave and Almuth Grésillon, Paris, CNRS Editions, 2000, pp. 191–212.
[11] Karl-Heinz Hahn, Goethe-und-Schiller-Archiv. Bestandsverzeichnis, Weimar, 1961, p. 11, cité par Klaus Hurlebusch, « Rarement vit-on tant de renouveau. Klopstock et ses contemporains : Tenants d’une ‘esthétique du génie’ et précurseurs de la littérature moderne », in Écrire aux XVIIe et XVIIIe siècles, op. cit., pp. 169–189.
[12] Annick Louis, José Luis Borges : œuvre et manœuvres, Paris, L’Harmattan, 1997.
[13] Mazzino Montinari, La Volonté de puissance n’existe pas?, Texte établi et postfacé par Paolo d’Iorio, Paris, L’Éclat, 1998.
[14] Margreta De Grazia, Shakespeare Verbatim. The Reproduction of Authenticity and the 1790 Apparatus, Oxford, Claredon Press 1991.
[15] Lukas Erne, Shakespeare as Literary Dramatist, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, Appendix B, “Heminge and Condell’s ‘Stolne, and surreptitious copies’ and the Pavier quartos”, pp. 255–258.
[16] Sur la publication du Folio de 1623, cf. Charlton Hinman, The Printing and Proofreading of the First Folio of Shakespeare, Oxford, Clarendon Press, 1963; Peter Blayney, The First Folio of Shakespeare, Washington, The Folger Library, 1991; et Anthony James West, The Shakespeare First Folio: The History of the Book, Oxford, Oxford University Press, 2001.
[17] Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? », [1969], in Foucault, Dits et écrits, 1954–1988, sous la direction de Daniel Defert et François Ewald, Paris, Gallimard, 1994, pp. 789–821.
[18] John Heminge, Henrie Condell, “To the great Variety of Readers”, in Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, and Tragedies, London, 1623, A3.
[19] Roger Chartier et Peter Stallybrass, “Reading and Authorship: The Circulation of Shakespeare 1590-1619”, in A Concise Companion to Shakespeare and the Text, Edited by Andrew Murphy, Oxford, Blackwell Publishing, 2007, pp. 35–56.
[20] Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, L’apparition du livre, Paris, Albin Michel, L’Evolution de l’Humanité, [1958], Paris, Albin Michel, 1999.
[21] Guglielmo Cavallo, “Testo, libro, lettura”, in Lo spazio letterario di Roma antica, a cura di Guglielmo Cavallo, Paolo Fedele, Andrea Giardina, t. II, La circolazione del testo, Rome, Salerno Editrice, 1989, pp. 307–334, et “Libro e cultura scritta”, in Storia di Roma, a cura di Aldo Schiavone, t. IV, Caratteri e morfologie, Bologne, Einaudi, 1989, pp. 693–734. Cf. aussi Les débuts du codex, Publié par Aain Blanchard, Turnhout, Brepols, 1989.
[22] Armando Petrucci, “Del libro unitario al libro miscellaneo”, in Società e imperio tardoantico, Vol. 4, Tradizioni dei classici, transformazione della cultura, a cura di Andrea Giardina, Bari, Laterza, 1986, pp. 173–187. Traduction anglaise: Armando Petrucci, “From the Unitary Book to Miscellany”, in Armando Petrucci, Writers and Readers in Medieval Italy. Studies in the History of Written Culture, Edited by Charles M. Radding, New Haven et Londres, Yale University Press, 1995, pp. 1–18.
[23] Roger Chartier, “Language, Books, and Reading from the Printed Word to the Digital Text”, Critical Inquiry, “Arts of Transmission”, Edited by James Chandler, Arnold I. Davidson et Adrian Johns, Volume 31, Number 1, Autumn 2004, pp. 133–152.
[24] Colin H. Roberts and T. C. Skeat, The Birth of the Codex, Londres, Published for the British Academy by Oxford University Press, 1987; Les débuts du codex, Alain Blanchard (ed.), Turnhout, Brepols, 1989; et les deux essais de Guglielmo Cavallo, "Testo, libro, lettura", in Lo spazio letterario di Roma antica, Edited by Guglielmo Cavallo, Paolo Fedeli and Andrea Giardino (eds.), Rome, Salerno editrice, t. II, pp. 307–341, et “Libro e cultura scriitta", in Storia di Roma, Aldo Schiavone (ed.), Turin, Einaudi, t. IV, 1989, pp. 693–734.
[25] Peter Stallybrass, “Books and Scrolls: Navigating the Bible”, in Books and Readers in Early Modern England, Jennifer Andersen and Elizabeth Sauer (eds.), Philadelphia, The University of Pennsylvania Press, 2002, pp. 42–79
[26] Nicholson Baker, Double Fiold: Libraries and Assault on Paper, Londres, Vintage Books / Random House, 2001.
[27] Francis Goyet, Le sublime du “lieu commun”. L’invention rhétorique dans l’Antiquité et à la Renaissance, Paris, Champon, 1996.
[28] Milad Doueihi, La Grande Conversion numérique, Paris, Seuil, 2008.
[29] François Bon, Après le livre, Seuil, 2011, et et Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique, Paris, Seuil, 2011.
[30] Antonio R. de las Heras, Navegar por la información, Madrid, Los Libros de Fundesco, 1991, pp. 81–164.
[31] John B. Thompson, Books in the Digital Age. The Transformation of Academic and Higher Education Publishing in Britain and the United StatesCambridge, Polity Press, 2005, and Merchants of Culure. The Publishing Business in the Twenty-First Century, Cambridge, Polity Press, 2011.